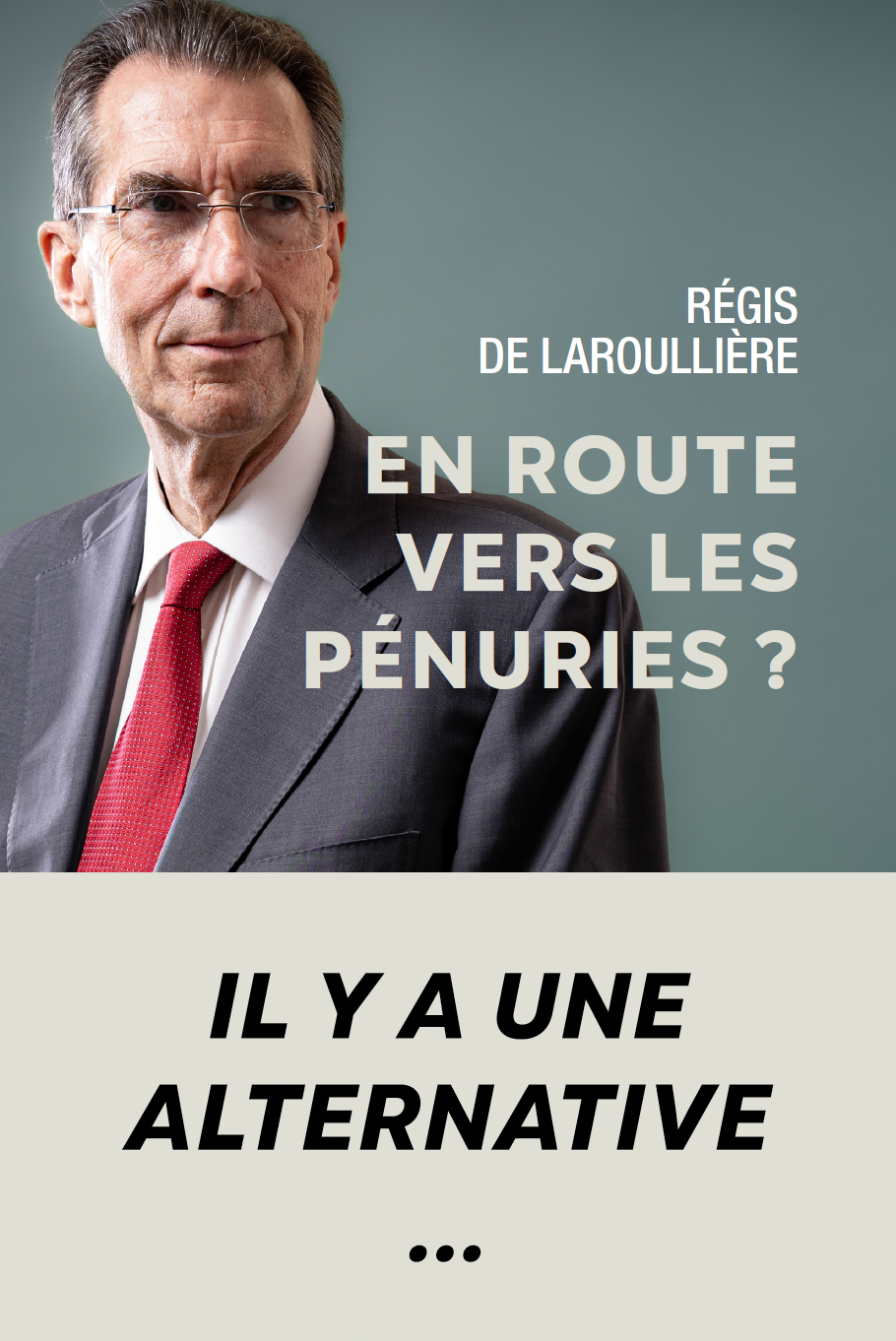Une protection sociale particulièrement généreuse
2025 marque le 80e anniversaire de la création de la Sécurité sociale. L’occasion de rappeler tout le bien que l’on pense de ce système de protection sociale le plus généreux et le plus redistributif au monde, dont nous nous plaisons à répéter que le monde entier nous l’envie. Avec 14 % du PIB redistribué aux retraités, des retraités dont le niveau de vie est très proche de celui des actifs ; un système de santé parmi les plus généreux (hors États-Unis, avec 11 % du PIB) et le plus faible paiement direct au monde ; des minima sociaux en tête des comparaisons internationales ; une redistribution élargie aux services publics bénéficiant à 57 % de la population et après laquelle l’éventail des rémunérations est particulièrement réduit. Nous trustons les podiums et les premières places dans la plupart de ces palmarès.
Deux ombres viennent toutefois ternir ce tableau.
Une ombre financière
Car nous fêtons également, plus discrètement, le 50e anniversaire du passage en déficit du budget de l’État. Notre déficit public est récemment devenu le plus important de l’Union européenne. Notre dette, mesurée par son ratio au PIB, n’est pas encore la plus élevée – il reste de la marge –, mais nous sommes à présent sur la troisième marche du podium. Notre ratio augmente, alors que ceux de la Grèce et de l’Italie, premier et second de ce palmarès, diminuent. La dynamique, mesurée par la prime de risque exigée de nos financeurs, est claire : à la date de rédaction de cet article (10 septembre, deux jours après le renversement du gouvernement Bayrou et lendemain de l’annonce de la nomination de Sébastien Lecornu comme Premier ministre), nous sommes en seconde position derrière l’Italie et devant la Grèce pour le taux à 10 ans (3,36 % pour l’OAT 10 ans le 6 septembre à comparer à 3,49 % pour l’Italie et 3,34 % pour la Grèce). Depuis l’été 2024, la prise de conscience progresse de ce que notre trajectoire en matière de finances publiques, et tout particulièrement de budget de l’État, n’est plus soutenable en l’état des taux d’intérêt. Leur charge pour 2025 est évaluée par le gouvernement à 66 milliards d’euros, qui deviendront plus de 100 milliards en 2029.
Entre l’envie d’améliorer la protection sociale – dont témoignent en dernier lieu les travaux du conclave des retraites avec la perspective de compensations accrues pour les femmes au titre de la maternité et d’une plus grande prise en compte de la pénibilité au travail – et la nécessité de redresser les finances publiques, c’est le grand écart. Les travaux du conclave n’ont pu aboutir, et nous nageons dans l’incohérence et la schizophrénie.
Le sujet budgétaire et celui de la protection sociale sont-ils d’un ordre de grandeur comparable ? Les déficits annoncés pour 2025 sont de 22 milliards pour la Sécurité sociale et de 139 milliards pour le budget de l’État. Mais de nombreuses prestations sociales sont financées par des prises en charge par l’État ou des transferts de ressources fiscales. Aussi, des observateurs extérieurs ôtent-ils les chiffres budgétaires pour mieux appréhender la réalité économique. Ainsi, Jean-Pascal Beaufret attribue aux dépenses de retraite la moitié des déficits publics et de la hausse de la dette depuis 2017 (1). Nicolas Dufourcq, lui, attribue à l’ensemble de notre système de protection sociale 2 000 milliards d’euros sur les 3 500 milliards de notre dette publique à fin 2025 (2).
Soyons lucides, nous ne traiterons pas le sujet des comptes publics sans traiter la dépense sociale. Nous n’irons pas ici plus loin sur les modalités du redressement des finances publiques, au cœur de l’actualité des débats politiques et budgétaires (3). Au-delà de la crise financière et des mesures de redressement qu’elle appelle, que pouvons-nous espérer à plus long terme pour notre système de protection sociale ?
Une ombre démographique
Une deuxième ombre vient ternir le tableau des mérites de notre système de protection sociale, apportée par les perspectives de notre démographie. Elle a deux composantes.
La première : le passage à la retraite des générations nombreuses du baby-boom. Depuis 15 ans, et pour les 15 prochaines années, le nombre des personnes de 65 ans et plus s’accroît de 250 000 en moyenne annuelle. Les besoins en matière de retraite et de santé, postes essentiels de notre système de protection sociale, augmentent. Simultanément, la population d’âge actif se contracte avant immigration et se maintient à peine après immigration. L’évolution de la productivité ne permet pas de compenser le manque d’heures travaillées engendré par ce phénomène. Le mouvement de baisse du chômage est à présent bien engagé, et de nombreux métiers sont à présent en tension.
À plus long terme, les perspectives démographiques ne sont pas meilleures. Dans 20 ans, les générations arrivant sur le marché du travail seront celles qui naissent actuellement (663 000 en 2024), à comparer à celles qui sont nées il y a 20 ans : 768 000 en 2004 et 784 000 en moyenne sur la période 2000-2010, déjà en retrait des générations du baby-boom. Si l’on se projette plus loin, avec un taux de fécondité stabilisé à 1,6, un groupe de 100 femmes a 76 filles, 58 petites-filles et 44 arrière-petites-filles. Avec un taux de fécondité qui rejoindrait celui de l’Italie (1,2), 100 femmes auraient 57 filles, 33 petites-filles et 19 arrière-petites-filles. De telles perspectives sont très défavorables à tout système de protection sociale. Un système économique et social est toujours un système qui permet de répartir la production entre investissement et consommation, et la consommation entre les actifs qui la produisent et en consomment une partie et les inactifs qui consomment sans produire.
Notre système a été conçu à une époque où le baby-boom n’était pas prévisible. Il était concentré sur les besoins les plus manifestes, et les prestations sociales ne représentaient que 10 % du PIB en 1945. L’âge de la retraite était de 65 ans, et l’assurance maladie prévoyait un important paiement direct (ticket modérateur). La formidable croissance des Trente Glorieuses (1946-1974) et l’arrivée massive sur le marché du travail de 1966 à 1995 des générations importantes du baby-boom ont apporté pendant 50 ans une ressource abondante, qui a permis à la fois une générosité croissante de notre système de protection sociale et une diminution de l’effort national d’activité : dans les comparatifs de l’OCDE, nous sommes le pays dont les habitants travaillent le moins sur l’ensemble de leur vie. Et nous avons progressivement pris un progrès permis par l’économie et la démographie pour une conquête économique et sociale.
Le reflux démographique engagé depuis 2006 avec le passage à la retraite des premières générations du baby-boom a été peu perçu, le chômage étant la préoccupation principale de l’époque. Mais ce reflux est déterminant sur les équilibres de notre système de protection sociale, essentiellement fondés sur la répartition des biens de consommation produits par les actifs entre eux-mêmes et les inactifs.
Prendre du recul et renouer avec nos fondamentaux
En soi, la décroissance démographique n’est pas un drame. Pour ce qui est du réchauffement climatique et de la surconsommation de ressources rares, c’est même une bonne nouvelle tant ce sont les activités humaines qui en sont à l’origine. Nous sommes encore un pays riche, même si nous déclinons dans les palmarès. S’adapter serait possible, en travaillant plus, en investissant et en robotisant davantage, en optimisant plus l’action et l’efficience publiques et/ou en redistribuant moins (4). L’immigration peut également apporter des éléments de réponse (5). Mais à présent que ni l’économie ni la démographie ne permettent d’équilibrer nos finances publiques en l’état, nous nous crispons sur nos acquis sociaux. Personne ne veut ni payer davantage de prélèvements obligatoires, ni bénéficier moins de la dépense publique, de la protection sociale ou de la redistribution. C’est un jeu perdant-perdant, analogue au dilemme du prisonnier, dans la mesure où l’absence de solution consentie conduit à une solution imposée, plus tardive et plus douloureuse, à l’exemple de ce qui s’est passé pour l’Allemagne, l’Italie et la Grèce.
Une solution consentie dans une approche coopérative nécessitera des efforts de tous, sans exception, tant la question « avons-nous trop dépensé ou pas assez prélevé ? » n’a pas de réponse univoque. Efforts différenciés, mais efforts de tous. Efforts mus par l’intérêt bien compris de chacun au demeurant, plus que sur un altruisme hors d’atteinte. Il ne s’agit pas de réduire plus ou moins uniformément la protection sociale, mais de la ramener à ce que nous sommes capables de financer et de la recentrer dans un double mouvement : la recentrer sur les besoins les plus essentiels – notamment ceux qui engagent la santé publique comme les vaccins – et sur nos concitoyens qui en ont le plus besoin. Il s’agit aussi de redonner à cette occasion davantage envie de travailler, tant à ceux qui bénéficient de la redistribution et ont moins besoin de travailler qu’à ceux qui y contribuent et sont dissuadés de travailler davantage par des prélèvements élevés. Ce double recentrage n’est-il pas une voie de progrès engageant notre prospérité comme notre souveraineté ?
La célébration du 80e anniversaire de la Sécurité sociale ne donne-t-elle pas l’occasion de prendre du recul par rapport aux difficultés financières et de renouer avec nos fondamentaux tels qu’ils sont synthétisés dans la devise nationale ? N’avons-nous pas pris l’habitude, pendant une longue période de prospérité économique et démographique, de mettre l’accent sur notre amour de la liberté et notre soif d’égalité, créatrices de droits, et oubliant la fraternité, créatrice de devoirs ? Le temps du retour de la fraternité française en quelque sorte. Sans elle, la liberté ne devient-elle pas en effet trop souvent égoïste, et l’égalité jalouse ?
Face à l’adversité financière et démographique, redécouvrir la fraternité ne serait-il pas un très beau cadeau d’anniversaire que nous pourrions nous faire ?
Références :
1 – Article publié dans la revue Commentaire n° 187 de l’automne 2024.
2 – La dette sociale de la France, en cours de publication chez Odile Jacob.
3 – Voir une analyse plus complète dans l’essai En route vers les pénuries ? Il y a une alternative… publié au Craps.
4 – Voir une analyse plus complète dans l’essai En route vers les pénuries ? Il y a une alternative…
5 – Voir le dossier du think tank Craps : « Immigration : trois éclairages sur les enjeux économiques et démographiques ».